Références
Gil CHARBONNIER et Franck PETIT, Quand la littérature moderne (ré)invente le droit. Œuvres choisies du XXe siècle à aujourd’hui, Lexis Nexis, Coll. Beaux Livres, 2023, 290 pages, ISBN 978-2-7110-3916-6, 45€.
Texte
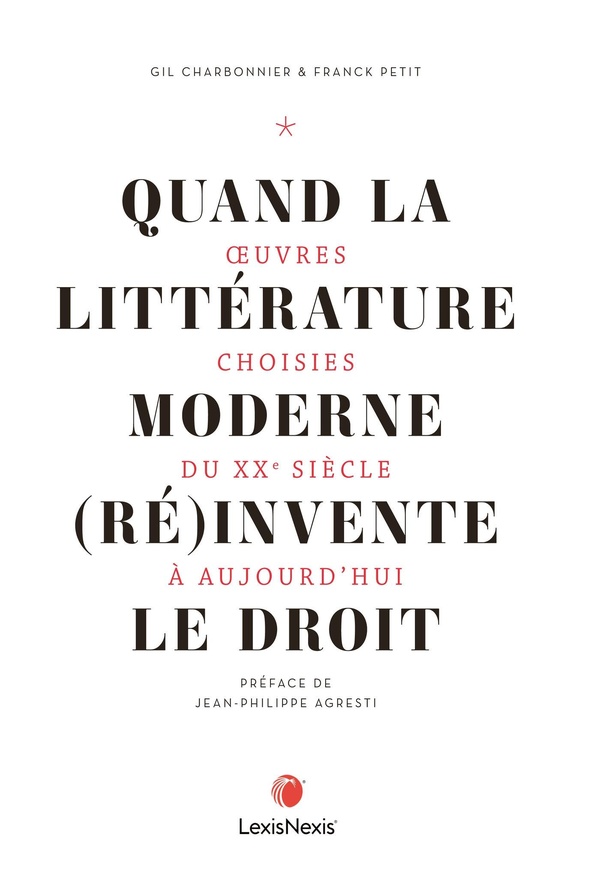
Quand la littérature moderne ré-invente le droit : tout un programme! Gil Charbonnier (PR en littérature française du XXe siècle) et Franck Petit (PR en droit social et droit du travail) ont écrit un ouvrage à quatre mains, fruit de longues années de recherches et de dialogues partagés entre droit et littérature. Leurs travaux les ont notamment amenés à co-créer une Double licence Droit/Lettres à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence en 2021. Ils défendent l’idée qu’aussi bien la recherche que l’enseignement du droit s’enrichissent du rapport étroit entre littérature, humanités et droit.
Dans le monde anglo-saxon, les cultural studies comme l’enseignement du droit croisent depuis longtemps les disciplines, avec l’ambition notamment de rapprocher par le biais du roman les juristes de la nature humaine et des réalités de la société civile, dans la lignée des préconisations du juge J.H. Wigmore[1] (en poste à Northwestern University 1934-1943). Pour ce dernier, côtoyer les grands textes littéraires (Balzac, Dickens …) contribue à exercer l’esprit critique du juriste et son regard réflexif dans sa pratique de la loi. Dans la tradition française des études juridiques, la démarche est plus récente et moins répandue que dans le monde anglo-saxon, même si la lecture des philosophes (à commencer par Rousseau et son Contrat social) et des grands textes littéraires (Les Misérables, Le Procès, …) se trouve sur la liste des prérequis des cursus juridiques. Une nouvelle dynamique est amorcée, comme le montre par exemple la création en 2017 de la Revue Droit et Littérature[2] et comme en témoigne cet ouvrage.
Le livre de Gil Charbonnier et Franck Petit est une invitation pour l’étudiant, le chercheur et l’enseignant à croiser droit français et littérature des XXe et XXIe siècles en vue de stimuler la curiosité du juriste ; il ne s’agit pas d’illustrer des textes de loi mais plutôt d’exercer l’acuité du juriste à détecter dans la littérature des cas juridiques, à le rapprocher des complexités de l’être l’humain. L’observation du monde se fait ainsi à travers le regard d’écrivains qui créent des « fictions du réel ». L’ouvrage ne constitue pas un recueil de textes commentés, mais de manière plus originale propose l’exposé de cas juridiques, contextualisés (exposés des faits, des fondements juridiques, du dénouement) tirés de la littérature.
Quand on prend en main le livre Quand la littérature moderne (ré)invente le droit, on est d’abord frappé par la qualité de l’édition : un beau livre broché de près de trois cents pages, pesant 1,08 Kg, calligraphié en rouge et noir, à la reliure soignée, riche en illustrations (affiches de cinéma, manuscrits, dessins de procès …). Très vite, l’ouvrage se feuillette avec gourmandise, sa conception permettant au gré des intérêts et des envies de découvrir ou d’approfondir l’un des huit thèmes explorés par les auteurs, sans avoir besoin de lire les chapitres précédents. Deux parties structurent le livre. Dans une première partie, qui à elle seule pourrait justifier la lecture de l’ouvrage, sont discutés les fondements méthodologiques et épistémologiques des travaux en droit et littérature dans une synthèse exhaustive et argumentée. Dans une seconde partie, sont développés huit chapitres thématiques autonomes (1. la création du droit, 2. la représentation de la justice, 3. la famille, 4. l’héritage, 5. la religion, 6. l’état de santé, 7. le monde-socio-économique, avec un développement consacré à l’éthique de l’Union européenne, 8. Le procès pénal) dans lesquels des articles de loi sont confrontés à différents textes littéraires contemporains, avec beaucoup d’érudition, de pédagogie et un solide appareil critique.
Le choix du corpus est novateur : il s’appuie sur trente-trois textes publiés entre 1912 et 2022, principalement des romans et quelques essais, aussi bien des classiques (Camus, Gide, Tournier…) que des textes moins connus. Chaque chapitre thématique comporte une introduction suivie de l’analyse critique des ouvrages sélectionnés (entre trois et sept selon les thèmes) avec systématiquement pour chacun, en premier lieu, un rappel du contexte juridique dans lequel se place l’intrigue (par exemple une analyse de ce que représente la loi dans le roman éponyme de Roger Vailland), puis un rappel des fondements juridiques corrélés (énoncé concis des articles de loi pertinents) et, enfin, une présentation des textes (intrigue, personnages,…) avec une mise en exergue du cas juridique (quelle constitution choisir ? même Robinson sur son île est confronté à la question). Bien souvent l’analyse du cas est doublée d’une analyse économique, dans une gymnastique intellectuelle familière des cursus pluridisciplinaires de Langues étrangères appliquées où droit, économie, histoire se répondent. A cet égard, il aurait pu être intéressant dans un lexique de préciser davantage les concepts, même si les références sont toutes indiquées. Autre léger bémol, une annexe resituant les auteurs choisis[3] aurait pu être utile afin de compléter un appareil critique déjà il est vrai étendu et argumenté.
Le livre est riche d’enseignements. Sur le plan méthodologique, il propose une méthode pour analyser un texte littéraire à l’aune du droit ; il ne s’agit pas d’utiliser la littérature comme simple illustration d’un texte de loi, mais bien d’analyser le potentiel juridique du texte, de comprendre comment une situation juridique peut-être mise en scène (inventée) et résolue (que ce soit un inventaire successoral, une situation de harcèlement au travail, un procès bâclé …) et d’amener une réflexion sur le droit (pénal, civil, constitutionnel, …), sur sa portée et sur son évolution. Le programme de recherche proposé est stimulant. Un deuxième apport réside dans l’enrichissement mutuel de la langue littéraire et juridique ; de ce point de vue, la connaissance réciproque des écrivains et des juristes de leurs disciplines est essentielle. Enfin les auteurs s’interrogent sur la façon dont le droit peut transposer les attentes sociales défendues par la littérature contemporaine, capable parfois de faire bouger les lignes (pensons par exemple au combat contre la peine de mort de Robert Badinter) et ainsi ré-inventer le droit. Par sa démarche, en cherchant les interactions entre droit et littérature, le livre se rapproche de la philosophie du droit et de l’histoire du droit.
Le livre de Gil Charbonnier et Franck Petit permet d’adapter au cas français, et de contribuer à populariser, une approche croisée droit/littérature. Pour des étudiants en droit ou en langues étrangères appliquées, il présente l’opportunité de s’interroger sur l’écrit juridique, sa méthode d’élaboration, et de travailler sur des cas pratiques, remettant l’humain au cœur de la réflexion ; il propose en outre une voie de recherche prometteuse. A travers des cas issus de la littérature contemporaine et ultra-contemporaine, de nombreux questionnements (dilemmes du personnel judiciaire, éthique économique du monde des affaires, …) sont soulevés et la réponse juridique décortiquée au scalpel. Gageons que cet ouvrage devrait aviver le goût de lire les romans et les textes juridiques, pour lesquels l’interprétation et le regard réflexif sont déterminants, et susciter l’analyse juridique de nombreux autres cas littéraires.
___
NOTES
[1] Cf. par exemple Arnaud COUTANT, La pensée juridique de… John Henry Wigmore, Mare & Martin Eds, 2024.
[2] Revue Droit et Littérature, Editions LGDJ (https://www.lgdj-editions.fr/livres/revue-droit-litterature-n1-2017/9782275056050)
[3] Difficile de mettre par exemple Camus et Drieu de La Rochelle sur le même plan ; certains auteurs en outre sont juristes de formation (JD Bredin par exemple), d’autres non.
Auteurs
Alice FABRE
Université Aix-Marseille, AMSE, CNRS
https://orcid.org/0009-0007-4176-5877
alice.fabre @ univ-amu.fr
Références
Pour citer cet article :
Alice FABRE - "Gil CHARBONNIER et Franck PETIT, Quand la littérature moderne (ré)invente le droit Œuvres choisies du XXe siècle à aujourd’hui" RILEA | 2025, mis en ligne le 14/11/2025. URL : https://anlea.org/revues_rilea/gil-charbonnier-et-franck-petit-quand-la-litterature-moderne-reinvente-le-droit-oeuvres-choisies-du-xxe-siecle-a-aujourdhui/