Références
Annette LENSING, Du nazisme à l’écologie. August Haußleiter et la politique allemande au XXe siècle, Peter Lang, 2024. ISBN (PDF) : 9783631921401. ISBN (ePUB) : 9783631921418. ISBN (Relié) : 9783631777060, 83,77€
Texte
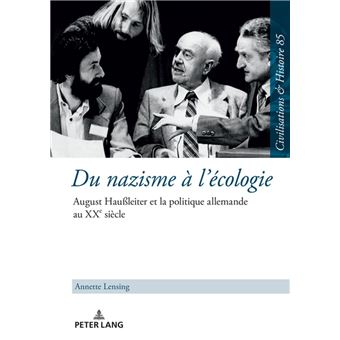
La monographie qu’Annette Lensing consacre à August Haußleiter, l’un des fondateurs du parti écologiste ouest-allemand Die Grünen (1979 / 1980), donne à voir une trajectoire à la fois souvent tortueuse, ambiguë et difficile à classer dans les catégories droite-gauche. Ce faisant elle développe une réflexion sur les évolutions sociétales et politiques de l’Allemagne du début du XXe siècle jusqu’à la veille de la chute du mur de Berlin et la réunification. Annette Lensing se situe au cœur d’un renouveau du genre biographique (biographical turn[1], p. 39) et propose de tracer le portrait « d’un propagandiste de la Wehrmacht devenu un militant pacifiste, neutraliste et écologiste après avoir côtoyé des acteurs de l’extrême droite ouest-allemande » (p. 21). Peter Bierl, qui regrettait dans un article paru en 2023 l’absence d’une biographie de référence dédiée à Haußleiter, formule le paradoxe que paraît incarner sa carrière encore plus radicalement : « Comment un homme politique dont les propos justifiaient qu’on le qualifie de ‘nazi’ a-t-il pu devenir le père fondateur d’un parti qui, jusqu’à aujourd’hui, est considéré comme étant en quelque sorte ‘de gauche’ ? »[2] C’est depuis longtemps, d’après lui, que les Verts auraient dû procéder à un examen critique de Haußleiter et des débuts de leur propre histoire « brune-verte ».
Annette Lensing a relevé ce défi tout en sachant « tirer profit de la tension entre une carrière en soi marginale et les moments et sujets clés de l’histoire allemande. » (p. 43) La carrière de Haußleiter n’est pas celle d’un Albert Speer – dont la biographie de l’historien Magnus Brechtken est citée à plusieurs reprises en guise de comparaison et surtout à propos du travail de mémoire (ou le manque de ce travail, les mensonges et les « oublis »)[3]. Si Haußleiter est une figure marginale dans le paysage politique après 1945, il appartient selon Lensing à l’élite fonctionnelle (« Funktionselite », p. 23) pendant le régime national-socialiste. Elle souligne qu’ « à l’exception du rôle qu’il joua pour la formation des Grünen à partir du tournant des années 1970-1980 et qui fut le point d’orgue de sa carrière, Haußleiter fut avant tout un Landespolitiker, un homme politique d’envergure régionale auquel l’expérience fédérale fit défaut » (p. 43). La plus grande réussite politique de Haußleiter consista visiblement dans le fait qu’il divisa le front des groupes de droite qui avaient dominé les débuts du parti écologiste entre 1977 et 1980, et facilita la coopération avec les courants féministes et de gauche, ce qui rendit possible la création des Verts[4]. Sa marginalité lui aurait permis en fait de se situer au-delà du clivage droite-gauche pour rassembler en dépassant les frontières générationnelles, idéologique et partisanes (p. 44).
Le travail d’Annette Lensing suit un ordre chronologique et comprend quatre grandes parties composées chacune de deux chapitres. La première est consacrée à la socialisation, aux expériences et aux représentations de Haußleiter dans la première moitié du XXe siècle. Né le 5 février 1905 à Nuremberg d’un père pasteur protestant, il perd très jeune ses parents. Adhérent de la première heure à la NSDAP, il faillit participer au « putsch de la brasserie » aux côtés d’Adolf Hitler et du général Ludendorff sans qu’on comprenne bien comment et pourquoi. Alors que le parti est dissout après le coup d’état et refondé en 1925, il ne réadhère plus à ce moment-là. Il poursuit ensuite des études de théologie et de philosophie à l’université d’Erlangen et travaille durant les années 1930 comme rédacteur pour le Fränkischer Kurier à Nuremberg avant que les conflits avec le Gauleiter Julius Streicher ne l’obligent à démissionner. Il continue pourtant d’y publier des écrits et reportages de guerre jusqu’en 1944. Mobilisé dans la Wehrmacht en 1940, il participe à l’invasion de l’Union soviétique, avant d’être affecté sur le front occidental. Il est blessé à Voronej en 1942 et publie en novembre de la même année une série de quatre articles publiés sur cette expérience. A. Lensing dédie un chapitre entier à l’analyse du journal de guerre An der mittleren Ostfront et des extraits des reportages de guerre en mettant l’accent sur la place qu’y prennent les deux notions « communauté » et « Heimat ». Si elle commente peu la « grande métamorphose » (« Die große Verwandlung ») qui donne le titre à l’un des quatre articles, Lensing souligne qu’à aucun moment Haußleiter n’évoque dans ses écrits les exactions commises par la Wehrmacht et les Sonderkommandos. La propagande exigeait sans aucun doute qu’il participe à « la célébration de la communauté des soldats au service de la légitimation de la politique de conquête nationale-socialiste et de la présupposée supériorité politique et morale du pays ». (p. 98)
La deuxième partie du livre traite de l’immédiat après-guerre, qui correspond à l’entrée d’August Haußleiter dans la vie politique active (1946-1949). Employé quelque temps comme enseignant auxiliaire il vit alors à Neudrossenfeld, dans le district de Kulmbach, en Haute-Franconie. Il obtient d’abord deux mandats parlementaires en Bavière, pour l’Union chrétienne-sociale de Bavière (1946-1950), puis pour la Communauté allemande (DG, 1950-1954), parti rassemblant les « laissées-pour-compte » (les victimes de la guerre, à savoir les expulsés, les anciens prisonniers de guerres, les victimes de la guerre et des bombardements, les anciennes soldates et les veuves de soldats tombés ou disparus). En 1963, il se maria en secondes noces avec Renate Malluche, sa plus proche confidente politique. Née en 1917 à Breslau (Wroclaw), elle fait partie des 2 millions Allemands qui arrivent en Bavière à la suite de leur expulsion des Sudètes et des provinces orientales. (p. 242) Membre du NSDAP avant la guerre, elle s’engage elle aussi politiquement après 1945 entre autres dans la DG et l’AUD à côté de Haußleiter.
La dénazification oblige Haußleiter à revenir sur ses engagements pendant la guerre ainsi que sur la forme et le contenu de son journal de guerre An der mittleren Ostfront. Alors que, n’arrivant pas à critiquer son travail de propagandiste, il se présente néanmoins comme un « non »-nazi (p. 149), son mandat parlementaire est suspendu. Lensing montre très clairement comment la dénazification a marqué la lutte pour le pouvoir politique au sein des partis et a également été utilisée comme arme politique. Les mêmes arguments, mécanismes et intrigues internes devaient par ailleurs plus tard conduire à la démission de Haußleiter du trio de tête du parti Die Grünen. (p. 151)
La troisième partie de l’ouvrage éclaire l’influence de la doctrine du neutralisme national qu’August Haußleiter défend à l’intérieur de la DG (Deutsche Gemeinschaft, Communauté allemande, 1949-1965). Les figures dominantes de la politique allemande d’après-guerre, telles que Konrad Adenauer (intégration à l’Ouest) ou Willy Brandt (Neue Ostpolitik), font parfois oublier l’importance de ce troisième camp, qui envisageait l’Allemagne comme un pays neutre entre les deux blocs de la guerre froide. Haußleiter critique la démocratie libérale et accorde une priorité à l’unité nationale par rapport à la création d’un Etat ouest-allemand.
La quatrième et dernière partie de l’ouvrage est consacrée à la fin de sa carrière politique et à son virage écologiste, couvrant une période allant de l’ouverture de l’AUD (Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher = Groupe d’action pour les Allemands indépendants) au mouvement écologiste aux derniers soubresauts de l’engagement du Haußleiter au sein des Grünen. L’AUD fit entrer les problématiques environnementales dans son programme et participa à la mobilisation antinucléaire des années 1970. Haußleiter réussit à ce moment-là à mettre en place une collaboration plus ou moins intense entre des nationalistes d’extrême droite, des anthroposophes et certains membres de la gauche contribuant au succès des Verts[5].
La compréhension de la carrière et des engagements publics d’une figure comme Haußleiter appelle des jugements nuancés. C’est le mérite de Lensing que de ne pas céder à la facilité en le condamnant sans procès. En s’intéressant aux manières dont il a raconté sa propre vie, aux traces qu’il a voulu laisser ainsi qu’aux interprétations qu’on en a données, elle éclaire sa trajectoire sous un angle à la fois riche et original. Son ouvrage est à ce titre une contribution significative à l’historiographie de la question nationale allemande d’après-guerre et plus généralement à la compréhension des transformations du paysage politique dans ce pays au cours de la période[6].
___
NOTES
Hildegard HABERL, Université de Caen Normandie, ERLIS 4254, hildegard.haberl@unicaen.fr
[1] Simone LASSIG, « Toward a biographical turn ? Biography in modern historiography – modern historiography in biography”, in German Historical Institute Bulletin, Washington, D.C. 15, 2004, pp. 147-155. D’autres germanistes-civilisationnistes de la génération d’Annette Lensing dédient leurs thèses à des biographies comme par exemple Bernier-Monod Agathe, Les fondateurs. Reconstruire la République après le nazisme, Lyon : ENS éditions, 2022.
[2] Peter BIERL, « August Haußleiter (1905-1989). Der grüne Gründervater », in Botsch, Gideon /Kopke, Christoph et Wilke, Karsten (ed.), Rechtsextrem: Biografien nach 1945, Oldenbourg: De Gruyter, 2023, pp. 165-187.
[3] Magnus BRECHTKEN, Albert Speer. Eine deutsche Karriere, München, 2017.
[4] Cf. Peter BIERL, op. cit., p. 166.
[5] Peter BIERL, op. cit., p. 186.
[6] Cf. Hélène MIARD DELACROIX, Question nationale allemande et nationalisme. Perceptions françaises d’une problématique allemande au début des année 50, Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2004.
Auteurs
Références
Pour citer cet article :
Hildegard HABERL - "Annette LENSING, Du nazisme à l’écologie. August Haußleiter et la politique allemande au XXe siècle" RILEA | 2025, mis en ligne le 06/11/2025. URL : https://anlea.org/revues_rilea/annette-lensing-du-nazisme-a-lecologie-august-hausleiter-et-la-politique-allemande-au-xxe-siecle/